Le patrimoine religieux : expression et inspiration de la foi chrétienne
Le caractère planétaire, tant de l’émotion provoquée par l’incendie de Notre-Dame de Paris, que de l’enthousiasme manifesté lors de sa réouverture ne manque pas d’interroger et d’interpeller.
On ne compte plus les monuments illustres qui, au cours des siècles, ont été détruits accidentellement ou volontairement rasés, sans que leur disparition n’ait suscité un tel désarroi et les choix architecturaux ou urbanistiques retenus pour leur reconstruction ou leur remplacement provoqué de telles controverses. Ainsi, combien de cathédrales gothiques n’ont-elles pas été édifiées sur les ruines d’une église romane ? De même, comment concevoir aujourd’hui que, pendant longtemps, Nantes ait pu être regardée comme la Venise de l’ouest ? Ce fut pourtant le cas jusqu’au comblement, entre les deux guerres, de plusieurs bras de la Loire et de l’Erdre.
Or, alors même qu’il est de bon ton d’oublier, voire de renier nos racines chrétiennes et que les catholiques pratiquants représentent désormais moins de 7 % de la population française, comment expliquer que l’incendie du sanctuaire d’une religion largement abandonnée ait été aussi amplement vécu comme un drame existentiel ?
Il y avait certes la crainte de la perte définitive d’un chef d’œuvre patrimonial. Mais, il y avait bien plus que l’attachement à l’art et à l’histoire. Comme l’a relevé le pape François dans le message qu’il a adressé à l’occasion de sa réouverture, il y avait aussi « le signe que la valeur symbolique et sacrée d’un tel édifice est encore largement perçue, du plus petit au plus grand ».
Témoignages de la foi des bâtisseurs, les chapelles, églises et cathédrales sont aussi des lieux de respiration et des sources d’inspiration. Au-delà de la description qu’on peut en faire, il y a ce qui peut y advenir au plus intime de chacun. Nombreux d’ailleurs sont les catéchumènes récemment baptisés qui pourraient l’attester.
De septembre 2023 à décembre 2024, les États Généraux du Patrimoine Religieux ont permis à l’Église de France d’engager une vaste démarche de réflexion nationale sur l’avenir du patrimoine religieux.
Naturellement, notre diocèse y a apporté sa contribution et celle-ci a été l’occasion d’un temps de discernement toujours en cours sur les enjeux de ce patrimoine et sur les réponses à apporter aux questionnements actuels résultant de la diminution du nombre d’actes de culte, de la demande croissante d’utilisations des églises, autres que cultuelles (en particulier culturelles) et du coût élevé de leur entretien.
Puissions-nous, en cette année jubilaire et dans l’attente de la réouverture prochaine de notre cathédrale, suivre l’exhortation du pape François : « Laissons-nous dès aujourd’hui attirer par l’espérance et faisons en sorte qu’elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. » (Spes non confundit).
Yves Pittard
Délégué épiscopal Dialogue, culture et société
Éditorial paru dans ELA n° 156 – Mars 2025
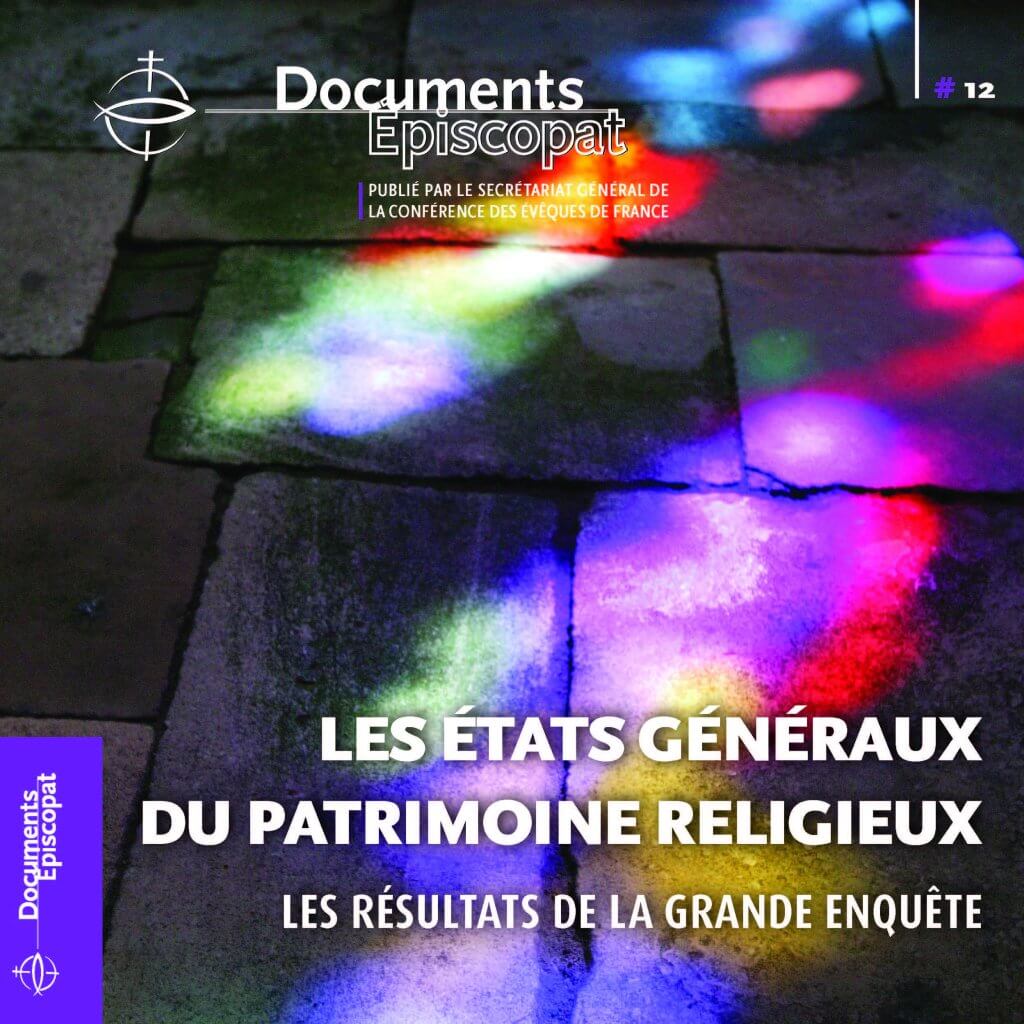 Un « Documents épiscopat » intitulé » Les États généraux du patrimoine religieux » vient de paraître. Il donne un coup de projecteur sur les résultats de la grande enquête nationale qui a permis de mettre le patrimoine de l’Église en évidence et d’en célébrer les acteurs, les formidables atouts et les défis des décennies à venir.
Un « Documents épiscopat » intitulé » Les États généraux du patrimoine religieux » vient de paraître. Il donne un coup de projecteur sur les résultats de la grande enquête nationale qui a permis de mettre le patrimoine de l’Église en évidence et d’en célébrer les acteurs, les formidables atouts et les défis des décennies à venir.
















